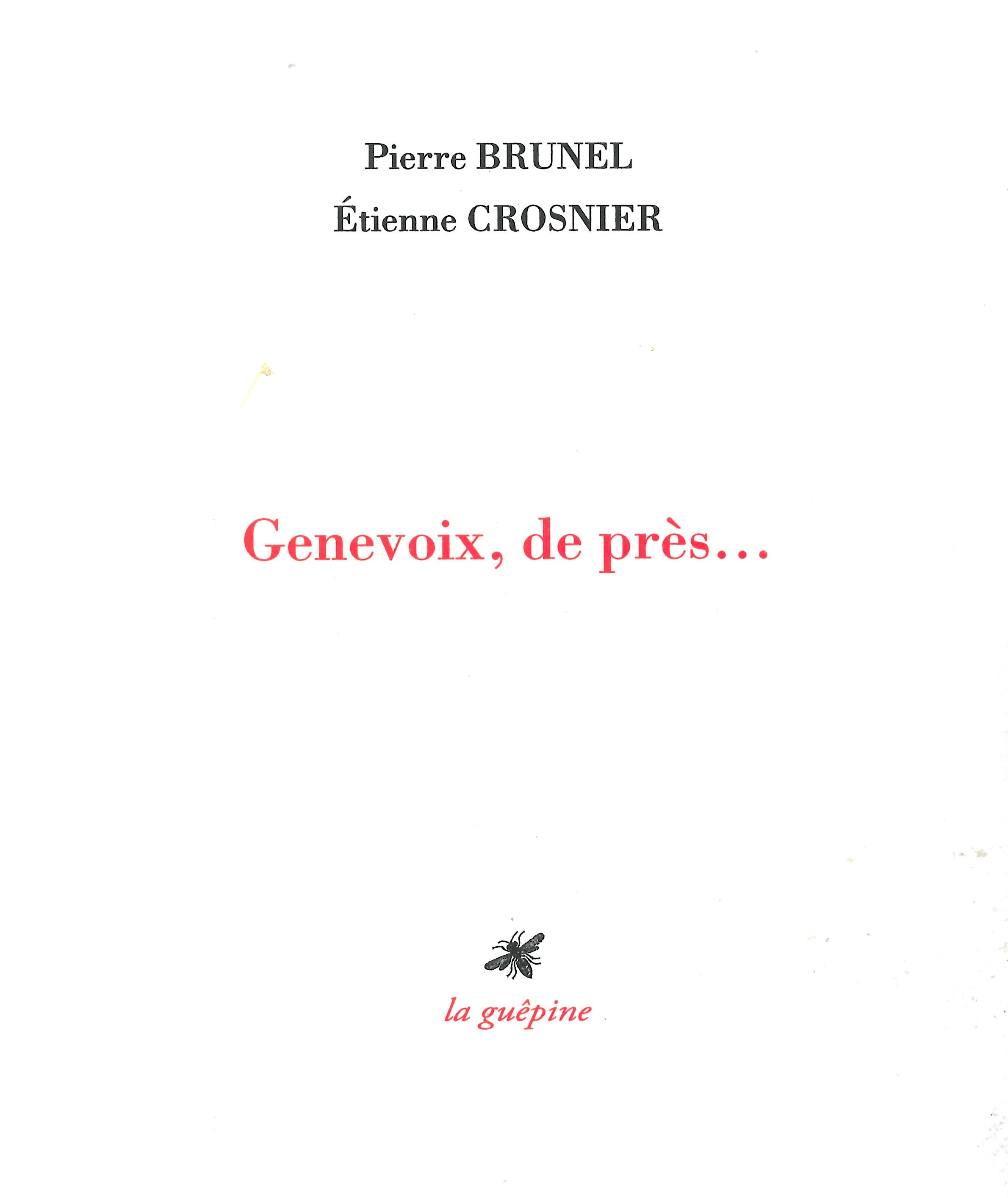 Au moment où Maurice Genevoix et, avec lui, les combattants de 1914-1918 entrent, trop tardivement, au Panthéon, Pierre Brunel et Étienne Crosnier publient aux Éditions La Guêpine un livre à deux voix intitulé Genevoix, de près… dont le titre renvoie au texte si fort, récit et méditation à la fois, que celui-ci publia en 1972 sous le titre La mort de près et que les éditeurs de la version intégrale de Ceux de 14 (Éditions Omnibus) ont eu la bonne idée de publier en épilogue à celle-ci, bien qu’il fût publié plus de cinquante ans plus tard.
Au moment où Maurice Genevoix et, avec lui, les combattants de 1914-1918 entrent, trop tardivement, au Panthéon, Pierre Brunel et Étienne Crosnier publient aux Éditions La Guêpine un livre à deux voix intitulé Genevoix, de près… dont le titre renvoie au texte si fort, récit et méditation à la fois, que celui-ci publia en 1972 sous le titre La mort de près et que les éditeurs de la version intégrale de Ceux de 14 (Éditions Omnibus) ont eu la bonne idée de publier en épilogue à celle-ci, bien qu’il fût publié plus de cinquante ans plus tard.
Pierre Brunel, dont je suivis jadis les cours d’agrégation, infatigable chercheur de correspondances entre toutes les littératures – on appelait cela la « littérature comparée » – nous offre un vagabondage littéraire autour de deux rencontres avec Genevoix. La première devait être triviale, mais elle le marqua beaucoup. Il s’agissait pour le jeune « conscrit » (élève de première année de l’École normale supérieure) de venir proposer à l’illustre ancien qu’était Maurice Genevoix deux « cartes de bal » qui donnaient droit à l’entrée au rituel bal de l’école. On ne saura jamais si les deux filles de l’écrivain, secrétaire perpétuel de l’Académie Française, ont honoré de leur présence cette manifestation. Ce qu’on apprend, en revanche, c’est que « chacun des mots qu’il prononça au cours de l’entretien » fut « comme un signe chargé d’une résonance lointaine » qui l’« l’atteignait au-delà de la lettre. »
La seconde de ces rencontres eut lieu à la Sorbonne. Pierre Brunel rapporte la colère qui y fut exprimée par Genevoix à l’encontre de Raymond Radiguet. Il évoque aussi, en cette occasion, combien les livres réunis dans Ceux de 14 se voulaient d’abord des témoignages, au plus près de la réalité, et de ce qu’elle recelait de terrible, excluant toute forme de romanesque : « C’est de propos délibéré que je me suis interdit tout arrangement fabulateur, toute licence d’imagination après coup. J’ai cru alors, je crois toujours, qu’il s’agit là d’une réalité si particulière, si intense et dominatrice qu’elle impose au chroniqueur ses lois propres et ses exigences. »
Dans le même ouvrage, Étienne Crosnier pourfend à très juste titre l’idée convenue et fallacieuse selon laquelle il y aurait deux œuvres distinctes dans l’œuvre de Genevoix. D’abord les chroniques de guerre et puis des romans et contes champêtres, rustiques, animaliers, magnifiant la nature, la forêt, la Loire et la Sologne… Il y aurait en quelque sorte une épopée suivie d’une somme d’écrits quasiment régionalistes.
Or, rien n’est plus faux. Parce que, d’abord, dans les deux cas, nous sommes emportés par la force, la richesse de l’écriture – son rapport si étroit au réel, quel qu’il soit.
Mais aussi parce que les mêmes obsessions, les mêmes obstinations se retrouvent dans les deux versants de l’œuvre. Étienne Crosnier le montre concrètement en analysant deux livres qui sont des « romans poèmes » selon l’expression forgée par Maurice Genevoix lui-même : La dernière harde et La forêt perdue.
Et parmi ces obsessions et obstinations, il y a précisément La mort de près, cette mort que Maurice Genevoix côtoya à quatre ans, lorsqu’il fut atteint de diphtérie, cette mort d’un rouge-gorge qui marqua pour toujours l’enfant qu’il était, cette mort de sa mère qu’il apprit, lycéen, « par un matin d’avant printemps d’une magnificence indicible », cette mort qui fut sa compagne dans les tranchées de la guerre, aux Éparges, chaque jour, chaque heure et chaque nuit, cette mort qui revint rôder avec la grippe espagnole… et qui revient dans les « romans poèmes », car « la biche ou la tourterelle à l’agonie », les bêtes qui se battent contre d’humains prédateurs qui apportent la mort font irrépressiblement penser aux soldats qui tombent sous le soleil ou dans les lumières de la nuit.
Lui, Genevoix, témoigne. Il écrit et décrit. Il croit que la restitution du réel a plus de poids que les discours moralisateurs.
Il écrit aux Vernelles, cette maison ligérienne entre Châteauneuf-sur-Loire et Saint-Denis-de-l’Hôtel, bâtie à l’ombre des vernes qui sont les « aulnes de la Loire » ; il écrit en regardant la Loire couler et en songeant que par-delà les horreurs de la guerre et les brutalités de la nature, si belle indissociablement, comme l’humanité sait l’être, il faut « cultiver l’amour du vivant pour faire reculer la barbarie. » Il pense que la littérature est œuvre de paix.
L’épilogue de La mort de près décrit le regard de trois mourants, trois de ses camarades. L’un d’entre eux « a passé les yeux ouverts, nous laissant le souvenir de son visage pacifié. » Et d’un autre, il nous dit : « Nos yeux ont vu s’effacer de ses traits la crispation douloureuse qui les nouait, et sur eux, jeune et tendre, presque enfantin, la lente lumière d’un sourire. »
Et Maurice Genevoix conclut d’une courte phrase : « Comment irai-je au-delà ? »
Jean-Pierre Sueur