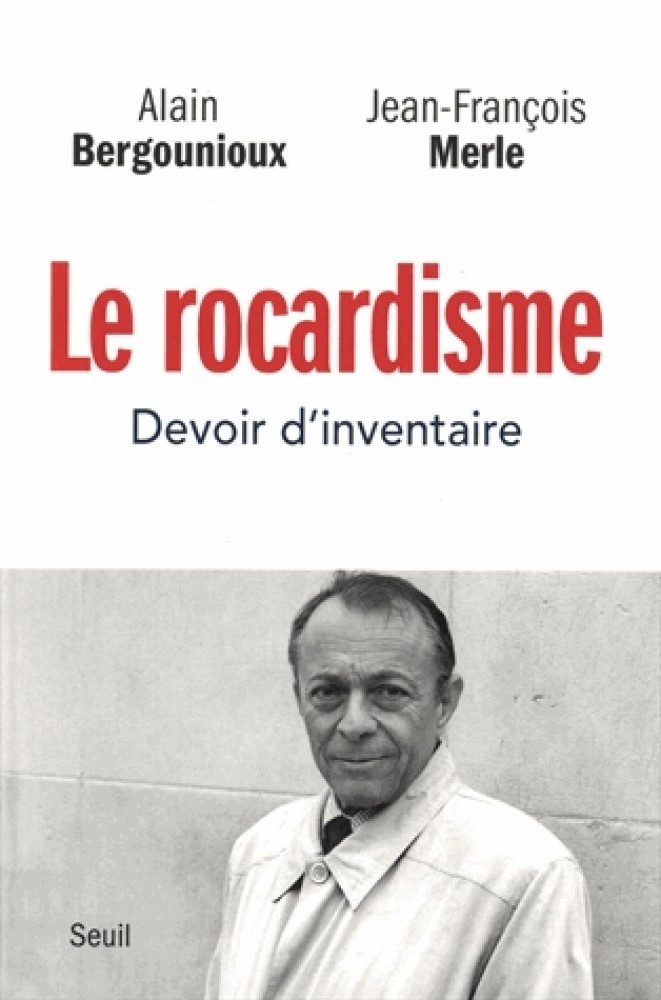
L’ouvrage qui vient d’être publié par Alain Bergounioux et Jean-François Merle sous le titre Le rocardisme. Devoir d’inventaire (éditions du Seuil) était plus que nécessaire. En effet, après avoir été sévèrement combattu, Michel Rocard a été tellement récupéré – parfois par ceux-là mêmes qui l’avaient combattu –, on s’est tant approprié son action et son héritage, qu’il était salutaire que nos deux auteurs, qui l’ont constamment soutenu, fassent avec rigueur et sans complaisance (Michel Rocard n’eût pas aimé la complaisance) une histoire et un inventaire du rocardisme.
Pour avoir moi-même été profondément marqué par l’apport de Michel Rocard, que je crois considérable, après celui de Pierre Mendès-France (mais il y avait entre les deux hommes beaucoup de points communs), j’ai lu avec un grand intérêt cet ouvrage qui va à l’essentiel.
L’essentiel, c’est que Michel Rocard a rénové le discours de la gauche qui, très marquée par vingt-trois ans d’opposition, n’avait pas eu l’opportunité de rénover sa pensée comme il l’aurait fallu.
Michel Rocard a d’abord réhabilité le marché – ce qui, à l’époque, parut presque scandaleux. Il a expliqué que le marché était plus apte à répondre aux « milliards d’équations » qu’induisait une économie ouverte que n’importe quelle puissance étatique ou bureaucratique.
Mais il ajoutait aussitôt que, pour nécessaire qu’il fût, le marché souffrait du défaut d’être myope. La puissance publique était donc indispensable afin de réguler l’économie, d’imposer l’impérieux sens de l’intérêt général et de mettre en œuvre de tout aussi impérieuses solidarités.
Le socialisme moderne serait celui qui trouverait de nouvelles formes d’action publique dans une économie ouverte, largement propice aux initiatives de tous les acteurs.
Il s’ensuivait que, pour nécessaire qu’il fût – ô combien ! –, l’État ne devait pas tout régenter.
Ainsi en allait-il en matière de nationalisations. Celles-ci étaient perçues et vécues avant 1981 – et après – par nombre d’hommes et de femmes de gauche comme le « marqueur » du changement. Contester la nécessité de nationalisations intégrales – à 100 % –, c’était pour beaucoup s’inscrire forcément dans une dérive droitière.
Or Rocard refusait de considérer les nationalisations comme un dogme. Il était à cet égard d’un total pragmatisme. Il y était favorable si elles permettaient d’orienter dans le sens de l’intérêt général certaines entreprises et certains secteurs industriels, particulièrement stratégiques. Il s’insurgeait contre le fait que certains tenaient à ce que l’État achetât tout, y compris les filiales, considérant qu’il suffisait de maîtriser 51 % du capital pour exercer le pouvoir.
Je me souviens du jour où, après examiné l’activité des filiales de certains grands groupes, il s’écria : « Mais enfin, l’État doit-il produire les cafetières ? »
On dira que tout cela est aujourd’hui dépassé. Mais ce fut un combat culturel autant que politique de grande ampleur.
Dans le même esprit, Rocard fut le chantre de la décentralisation. La première intervention qui le fit connaître fut son discours, prémonitoire, tenu lors d’un colloque, en 1966, sur le thème : « Décoloniser la province. »
Alain Bergounioux et Jean-François Merle ont aussi présenté la personnalité de Michel Rocard : « Il a toujours été l’homme du libre examen » ; il avait « une attention au temps long plutôt qu’à l’écume des choses » ; il s’attachait à « parler vrai » – cela devint son image de marque – quitte à devenir « briseur de rêves » ; il a toujours refusé le « clientélisme » et les « phénomènes de cour » – quitte à en subir les conséquences – ; il avait une réticence à l’égard des campagnes électorales durant lesquelles il fallait serrer des centaines de mains sur les marchés, exercice qui lui paraissait singulièrement factice.
Nos auteurs retracent l’histoire. Celle du jeune dirigeant des étudiants socialistes, adhérent à la SFIO ; celle de la rupture, lors de la guerre d’Algérie, qui le conduisit à créer avec d’autres le PSU ; sa volonté d’essayer, après Mai 68, de trouver d’impossibles synthèses au sein du PSU ; son arrivée au Parti socialiste, les congrès de Nantes, de Metz et la suite…
Ils retracent l’histoire des générations de « rocardiens » qui se sont attachés, au fil du temps, à ses idées et, indissociablement, à sa méthode.
Enfin, ils évoquent avec beaucoup de pertinence, ce qu’ils appellent le « rocardisme ministériel. »
Michel Rocard fut ministre du Plan. La principale innovation dont il fut l’auteur, à ce titre, ce furent les « contrats de plan. » Il avait compris que la planification sans fin vantée était devenue, au plan national, un exercice d’école. Il fallait, pour être efficace, que les collectivités locales, et tout particulièrement les Régions, fussent associées à l’exercice de prospective, évidemment nécessaire.
Les contrats de plan sont toujours en vigueur. Ils reposent sur un principe simple : pour chaque objectif, pour chaque action, l’État d’une part, et les Régions d’autre part, afficheront, pour chaque année, un chiffre précis. Ne pas respecter l’engagement pris, ce serait encourir une juste critique du partenaire. Parce qu’ils reposaient sur une logique contractuelle, les contrats de plan ont été efficaces : première illustration – il en y eut bien d’autres – de l’importance, pour Michel Rocard, du contrat dans la vie politique et sociale.
Ministre de l’Agriculture, Michel Rocard fut respecté des agriculteurs comme de ses partenaires européens. Je me souviens des critiques suscitées par les « quotas laitiers » qui permettaient de gérer rationnellement les volumes produits… et de la vive désolation des agriculteurs concernés – y compris ceux qui les avaient contestés – lorsque les instances européennes, cédant aux sirènes du « tout libéral », décidèrent de les supprimer… Alain Bergounioux et Jean-François Merle notent aussi la grande réussite que fut le vote à l’unanimité à l’Assemblée nationale comme au Sénat des lois sur l’enseignement agricole public et sur l’enseignement agricole privé – là encore le sens du dialogue et le choix du pragmatisme s’étaient révélés efficaces…
Devenu Premier ministre, en dépit du fait qu’il ne disposait pas de la majorité absolue (ce qui le contraint à recourir vingt-huit fois à l’article 49.3 de la Constitution…), Michel Rocard fit de grandes réformes. Nos auteurs évoquent longuement la création de la CSG comme celle du RMI. Ils expliquent combien le choix – encore une fois ! – du dialogue et du pragmatisme fut précieux pour régler le difficile problème calédonien. Ils rappellent aussi l’attachement de Michel Rocard à l’environnement, avec l’accord de La Haye qui devait présager son intense engagement, à la fin de sa vie, pour la planète – en particulier pour les « pôles », sujet sur lequel il s’investira pleinement.
Alain Bergounioux et Jean-François Merle insistent à juste titre sur le fait que Michel Rocard fut toujours fidèle au socialisme. Il prit sa première carte à la SFIO en 1949 et sa dernière au Parti socialiste peu avant son décès. Il croyait à l’action collective. Et cela le distingue d’un certain nombre de ceux qui voudraient se présenter comme ses héritiers, sans avoir la même ténacité, ni la même fidélité.
Je laisserai le mot de la fin à François Hollande, cité dans ce livre, qui, lorsqu’il lui remit la grand-croix de la Légion d’honneur, l’a définit comme « un rêveur réaliste et un réformiste radical. »
Jean-Pierre Sueur
