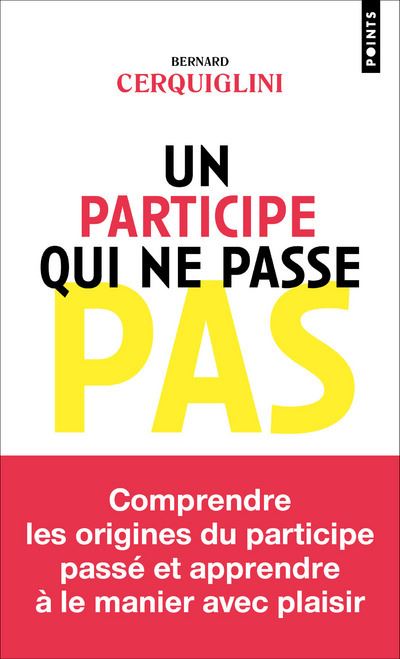
Éminent linguiste, mon camarade et ami Bernard Cerquiglini a le don de conjuguer dans ses écrits une connaissance intime de l’histoire de la langue française, un sens de la pédagogie et un sens de l’humour qui sont, l’un est l’autre, précieux lorsqu’on traite de sujets qui peuvent apparaître quelque peu austères.
C’est avec plaisir que nous retrouvons ces vertus dans son dernier opus consacré à la question, omniprésente dans nos grammaires, de l’accord du participe passé, dont le titre est Un participe qui ne passe pas (Éditions Points, collection « Le goût des mots »). Au travers du prisme de cette question qui paraîtra a priori limitée – mais qui ne l’est guère ! – Bernard Cerquiglini passe en revue toute l’histoire de la langue, mais aussi de la grammaire, de notre rapport à ses règles, ses normes et aux éventuelles réformes toujours évoquées et souvent différées…
(suite de la lettre électonique)
À vrai dire, Bernard Cerquiglini récidive. Car il nous a déjà offert – il y a vingt-cinq ans ! – un livre délicieux intitulé « L’accent du souvenir » (Éditions de Minuit) entièrement consacré à l’histoire de l’accent circonflexe qui, lorsqu’il fut introduit par des imprimeurs au XVIe siècle, suscita la vive opposition des puristes de l’époque qui considérèrent que cet « accent crochu » n’était assurément pas conforme au génie de notre langue (il fallut attendre deux siècles pour qu’il fasse son entrée dans le dictionnaire de l’Académie, en 1740)… et qui, quand il fut question de le supprimer à la fin du XXe siècle, là où il n’y avait vraiment aucune raison (ni étymologique, ni morphologique ni phonétique) de le garder, cette hypothétique suppression (très limitée d’ailleurs) suscita les cris d’orfraie des mêmes puristes… ou plutôt de leurs lointains successeurs !
Notons en passant que, fort hostile à l’accent circonflexe, l’auteur du projet de préface pour la première édition du Dictionnaire de l’Académie française, écrivait, au XVIIe siècle : « Notre compagnie déclare qu’elle désire suivre l’ancienne orthographe qui distingue les gens de lettres avec les ignorants et les simples femmes… »
Mais revenons au participe passé. Bernard Cerquiglini nous en explique la genèse. Il nous parle d’un temps – celui de l’ancien français et du moyen français – où l’accord ou l’absence d’accord dudit participe, donnait lieu à une liberté qui n’eut plus cours ensuite. Il nous explique d’où vient cette fameuse histoire de l’accord avec le complément d’objet du verbe avoir à la condition qu’il soit placé devant : dans l’ancienne langue, l’ordre sujet-verbe-complément n’était pas majoritaire, ce qu’on a bien oublié depuis.
Et puis il fait entrer en scène Clément Marot, grand poète, personnage fabuleux dont la vie fut une aventure (où l’on retrouve l’Orléanais Étienne Dolet, imprimeur, philosophe et grammairien), Clément Marot qui, dans ses épigrammes publiés en 1538, édite en vers la fameuse règle :
« Il faut dire en termes parfaits
"Dieu en ce monde nous a faits"
Et "Dieu en ce monde les a faites". »
La règle existe désormais. Elle s’impose d’autant plus qu’un an plus tard, François 1er signe l’édit de Villers-Cotterêts imposant la langue française dans la justice et l’administration.
Marot avait vécu en Italie. Bernard Cerquiglini nous rapporte ce propos, sans doute apocryphe, de Voltaire pour qui « Marot rapporte deux choses d’Italie : la vérole et l’accord du participe passé. » Et il ajoute : « Le second fit plus de ravages » !
Cela étant dit, il ne faut pas croire que la règle parût spontanément si naturelle qu’elle s’imposât rapidement.
Ainsi, au XVIe siècle, le cher Ronsard écrit-il ce magnifique poème que chacun connaît :
« Mignonne allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil »
où l’accord est manifestement fautif (puisque le complément d’objet direct suit le participe) sans que cela ait ému personne depuis quatre siècles !
De même, on s’est très tôt satisfait que le « participe » qui – nous dit Bernard Cerquiglini –, pour le coup, porte bien son nom, participe du verbe (il est alors invariable) et de l’adjectif (il est alors variable), ce qui n’empêche nullement Jean Racine d’écrire dans Andromaque ce vers sublime :
« Et la veuve d’Hector pleurante à vos genoux. »
Mais peu à peu, les choses se figent. Les règles prolifèrent, les exceptions aussi. Bernard Cerquiglini cite les dizaines et dizaines de grammaires éditées à de très grands nombres d’exemplaires qui développent les règles, qu’il s’agisse des participes construits avec être ou avoir, mais aussi des verbes pronominaux, des verbes suivis d’un infinitif, des verbes laisser ou coûter, etc.
Il nous conte en détail les projets de réforme, radicales ou non, de ce sujet et d’autres, qu’il s’agisse de grammaire ou d’orthographe… où l’on retrouve ce cher Michel Rocard, Pierre Encrevé et Bernard Cerquiglini lui-même, en tant qu’acteur… et la difficulté de la tâche !
J’ai souvent remarqué que les plus progressistes, voire gauchistes, se trouvaient être souvent très conservateurs dès lors qu’il s’agit de la langue, de la grammaire et de l’orthographe.
Même si toute langue vit, change, se transforme, même si les fautes d’hier deviennent la norme de demain… il est difficile de faire approuver toute réforme de ladite norme.
Je me suis parfois demandé si, dans l’inconscient collectif, il n’y avait pas ce raisonnement quelque peu pervers : « J’en ai tant bavé pour apprendre ces règles et cette orthographe (mais j’en ai bavé pour la bonne cause !) qu’il est juste que nos enfants connaissent les mêmes affres – toujours pour la bonne cause. »
Bernard Cerquiglini, qui ne perd donc pas le sens de l’humour, nous rapporte que lorsque Laurent Delahousse posa à Bernard Pivot cette question :« Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous lui entendre dire quand Il vous accueillera ? » sa réponse fut la suivante : « Bonjour Pivot. Vous allez pouvoir m’expliquer les règles d’accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Je n’y ai jamais rien compris. » Et Pivot d’ajouter : « Je lui répondrai, modeste : moi non plus Seigneur. »
… Pour la suite, Bernard Cerquiglini propose que l’on s’en tienne à une réforme réaliste : limiter l’accord du participe passé avec avoir lorsqu’il y a un complément d’objet direct antéposé – et, si je comprends bien, s’en tenir là pour le reste.
Bien sûr, on peut rêver de positions plus radicales. Mais celle que suggère Bernard est le fruit de longues études et d’une vraie sagesse.
Et puis, j’ai toujours préféré les réformistes qui font des réformes aux révolutionnaires qui ne font pas la révolution !
Jean-Pierre Sueur
-
Un participe qui ne passe pas, éditions Points, 200 pages, 7,20 €